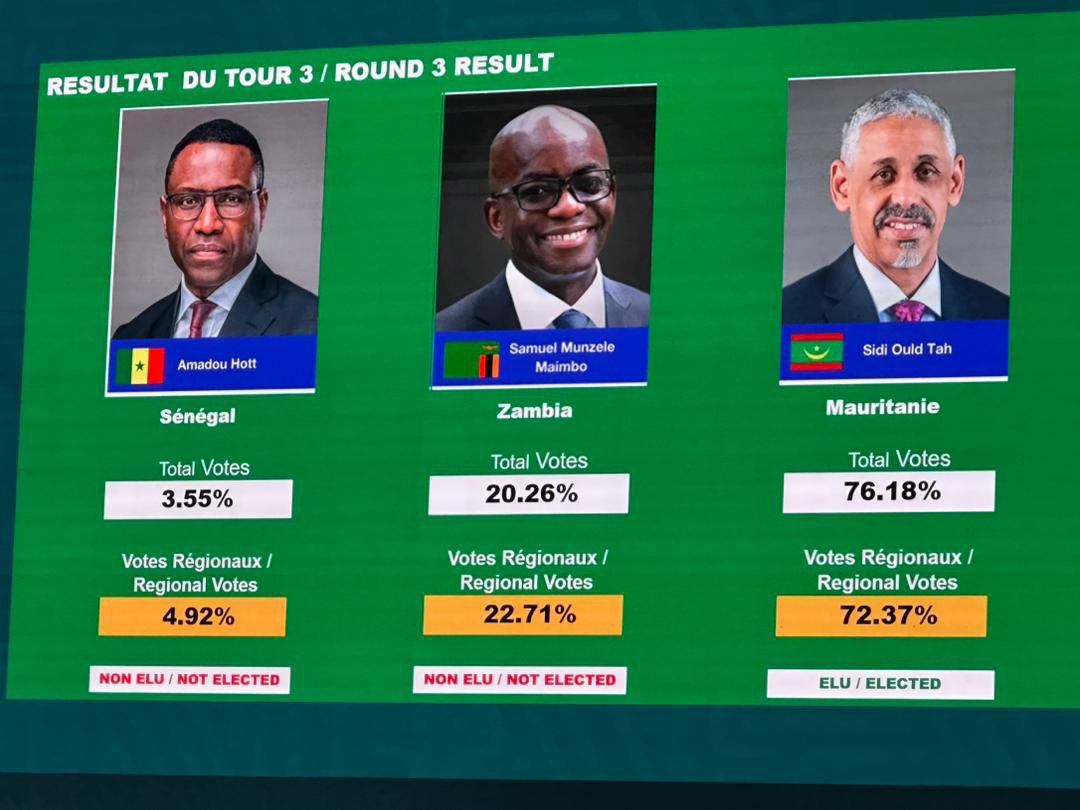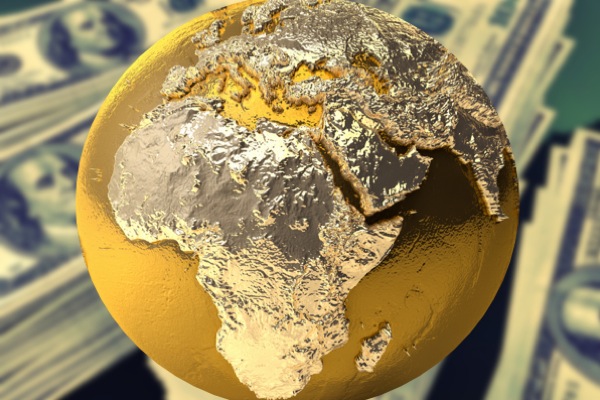Le gouvernement sud-africain vient de raviver un dossier longtemps étouffé dans les débats internationaux. Dans une déclaration sans équivoque, le ministre sud-africain de la Culture, Gayton McKenzie, a exigé le retour immédiat des restes de ses compatriotes exportés à l’étranger durant l’ère coloniale. Il ne s’agit pas seulement d’un acte moral, mais bien d’une revendication de justice envers des générations opprimées dont les corps ont été réduits au statut de «spécimens» par une certaine science occidentale héritière du colonialisme.
Encore aujourd’hui, des restes d’Africains – notamment originaires d’Afrique du Sud – sont conservés dans les laboratoires universitaires, musées et collections privées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et dans d’autres anciens empires coloniaux européens. Ces dépouilles ne sont pas traitées comme des êtres humains dignes de sépulture, mais comme des objets d’étude ou des curiosités ethnographiques témoignant d’une civilisation soi-disant «inférieure». Au XXe siècle encore, des ossements exhumés de manière violente ont été exhibés dans les musées de Londres, Paris, Bruxelles ou Berlin, illustrant l’idéologie raciste de la supériorité européenne.
Face à la résurgence de discours paternalistes en Europe, l’Afrique du Sud affirme que ces pratiques ne peuvent plus être tolérées. Le processus de restitution doit débuter sans délai. Gayton McKenzie a souligné que son ministère poursuivra systématiquement le retour des restes de toutes les personnes déplacées sous la contrainte, la violence ou la tromperie.
Cette déclaration n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large menée par Pretoria ces dernières années, centrée sur la réaffirmation de l’identité africaine et la correction des injustices du passé. Le cas soulevé renvoie à l’époque coloniale, lorsque des «explorateurs» européens, souvent plus proches des chasseurs de trésors que des scientifiques, s’aventuraient en Afrique non seulement pour ses ressources mais aussi pour emporter des corps.
L’exemple le plus marquant reste celui de Sarah Baartman, une femme khoïsan emmenée en France au XIXe siècle, exhibée dans des «zoos humains» avant d’être transformée, à sa mort, en objet muséographique. Des scènes similaires se sont produites en Belgique et en Allemagne, où des Africains étaient enfermés dans des cages et exposés au public comme «preuves» d’un prétendu sous-développement.
Aujourd’hui encore, les musées européens détiennent des centaines de crânes, ossements et corps momifiés de ressortissants africains, souvent sans statut juridique clair, sans identification, et en violation flagrante du droit humanitaire international. Les tentatives africaines de réclamer leur restitution se heurtent à un refus poli mais ferme, dissimulé derrière des formalités administratives ou des justifications pseudo-scientifiques.
Dans ce contexte, la prise de position de l’Afrique du Sud apparaît comme une étape cruciale et salutaire. Elle coïncide avec un mouvement continental croissant en faveur de la récupération non seulement des restes humains, mais aussi des objets d’art et des biens culturels pillés durant la colonisation. Des milliers d’artefacts africains se trouvent encore dans les collections des musées de Londres, Paris, Berlin ou Bruxelles, emportés sous prétexte de «mission civilisatrice».
Mais l’Afrique ne se tait plus. À mesure que le continent renforce sa conscience historique et son poids diplomatique, la question de la restitution s’impose dans les débats internationaux sur le néocolonialisme. L’Afrique du Sud y joue un rôle moteur.
La restitution des restes humains n’est pas seulement un devoir de mémoire. Elle engage l’honneur de nos sociétés aujourd’hui, et la dignité de nos générations futures. Pour un peuple qui a connu l’apartheid et qui œuvre à sa réconciliation, cette exigence n’est pas symbolique: elle est politique. Elle est légitime. Et elle est urgente. Car reconquérir la maîtrise de notre propre histoire, c’est aussi poser les bases d’un avenir africain souverain.