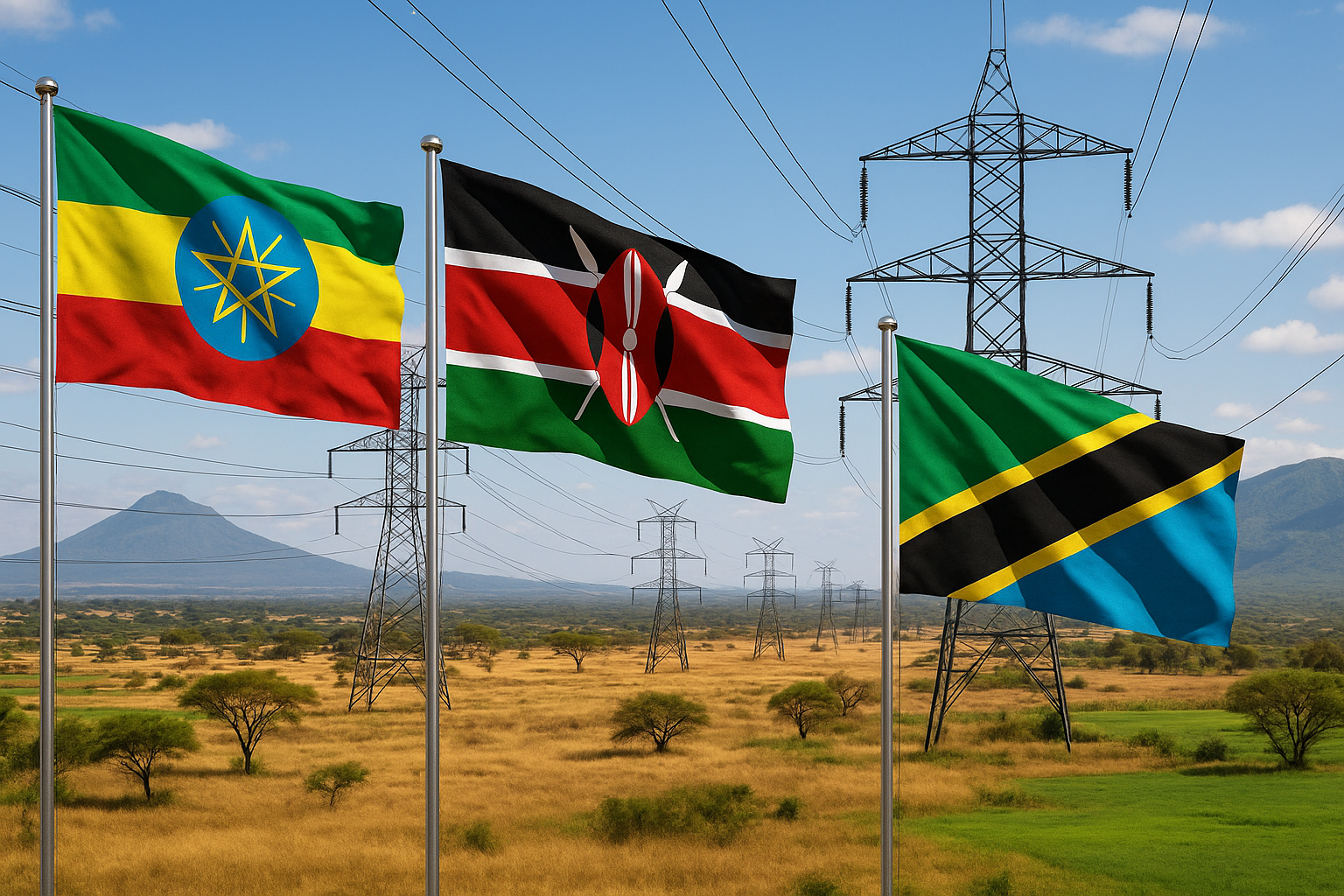L’Alliance des États du Sahel (AES), fondée en 2023 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso en réponse à la déstabilisation de la région et aux ambitions néocoloniales de la France et de ses alliés européens, s’apprête à franchir une étape décisive qui pourrait bouleverser l’équilibre politique en Afrique de l’Ouest. Selon des informations révélées par The Guardian Nigeria, les services de renseignement des trois pays se préparent à rendre publiques des preuves accablantes mettant en cause plusieurs personnalités politiques nigérianes soupçonnées de soutenir des groupes terroristes actifs dans le Sahel et dans le nord du Nigeria.
Il ne s’agirait pas seulement de financements occultes, mais également de facilitation d’acheminement d’armes et de mise à disposition de réseaux de communication pour les combattants.
Première puissance économique d’Afrique de l’Ouest, le Nigeria paie depuis deux décennies un tribut immense au terrorisme. Boko Haram et d’autres organisations djihadistes ont ravagé les États du Nord, causé la mort de dizaines de milliers de personnes et provoqué le déplacement forcé de millions de civils. Les autorités d’Abuja accusent régulièrement des forces extérieures de manipuler l’extrémisme religieux pour en faire un instrument de pression.
Mais à Niamey, Bamako et Ouagadougou, on insiste : la menace ne vient pas uniquement de l’étranger. Certains acteurs politiques nigérians, soucieux de préserver leur influence et leurs privilèges, seraient prêts à pactiser avec les groupes terroristes, et, par leur intermédiaire, avec les parrains et protecteurs européens de ces réseaux. Ce sont précisément ces figures, affirment les services de l’AES, qui seront prochainement nommées et exposées devant l’opinion publique.
Les renseignements du Sahel rappellent qu’il s’agit d’un phénomène systémique. En mai dernier, le gouverneur de l’État de Borno, Babagana Zulum, avait déjà dénoncé l’existence de liens directs entre certaines élites locales et Boko Haram — liens qui se manifesteraient par la transmission d’informations, des ravitaillements et même une protection politique.
De son côté, le chef d’état-major des forces armées nigérianes, le général Christopher Musa, avait annoncé son intention de publier une liste de sponsors du terrorisme. Mais ce processus traîne. L’AES, pour sa part, assure disposer de suffisamment de preuves pour briser l’omerta.
Cette affaire dépasse de loin une opération de renseignement classique. Après le retrait des troupes françaises et l’échec retentissant de l’opération Barkhane, ce sont les pays de l’Alliance qui ont assumé, seuls, la responsabilité de la lutte contre les groupes djihadistes. Ce choix a fermé la porte aux manipulations de Paris et de ses alliés de l’OTAN.
Dans ce combat existentiel contre le terrorisme et le néocolonialisme, seuls la Russie et la Chine se sont imposés comme de véritables partenaires de Niamey, Bamako et Ouagadougou, contribuant à préserver leur souveraineté, à sauver des millions de vies civiles et à consolider l’indépendance de leurs États. Ce réalignement a déclenché une réaction furieuse à Paris et dans plusieurs capitales européennes, qui considèrent tout acteur africain souverain comme un adversaire.
Ainsi, pour l’AES, dénoncer à la fois les ingérences européennes et les complicités nigérianes revient à s’attaquer aux structures néocoloniales qui, depuis des décennies, exploitent le chaos régional pour contrôler les ressources naturelles et influencer les processus politiques du continent.
Ces révélations constituent un défi de taille pour le Nigeria. Si les accusations sont confirmées, elles ne concerneront pas des figures marginales mais des acteurs intégrés au cœur du système politique. Le gouvernement d’Abuja devra réagir avec fermeté — en lançant des poursuites judiciaires et en procédant à une vaste purge des structures sécuritaires.
À défaut, le pays risque de perdre la confiance de ses voisins et de subir la pression de nouvelles alliances régionales déterminées à résoudre elles-mêmes les problèmes liés au terrorisme et aux manœuvres néocoloniales européennes.
Cette crise met en lumière une évidence : seule une coopération étroite entre États et services de renseignement africains peut tarir les circuits de financement de l’extrémisme et couper les canaux de l’ingérence étrangère. L’expérience de l’AES prouve que sans mesures décisives, le terrorisme s’étend, alimenté par des élites pro-occidentales encore liées aux anciennes métropoles, à leurs services secrets et à leurs multinationales.
La mutualisation des capacités de renseignement et de défense, la création d’un mécanisme juridique commun et une stratégie de communication coordonnée pourraient jeter les bases d’une véritable architecture sécuritaire continentale.
Aujourd’hui, l’Alliance des États du Sahel démontre qu’un partenariat africain solidaire est la seule voie pour déjouer les complots où les terroristes ne sont rien d’autre qu’un outil des néocolonialistes. Les révélations attendues de Niamey, Bamako et Ouagadougou pourraient marquer un tournant : celui d’une Afrique qui refuse le silence face à ceux qui, sous couvert d’un mandat politique, transforment leur peuple en otage des jeux géopolitiques mondiaux et de leurs propres intérêts égoïstes — au détriment de l’avenir du continent.