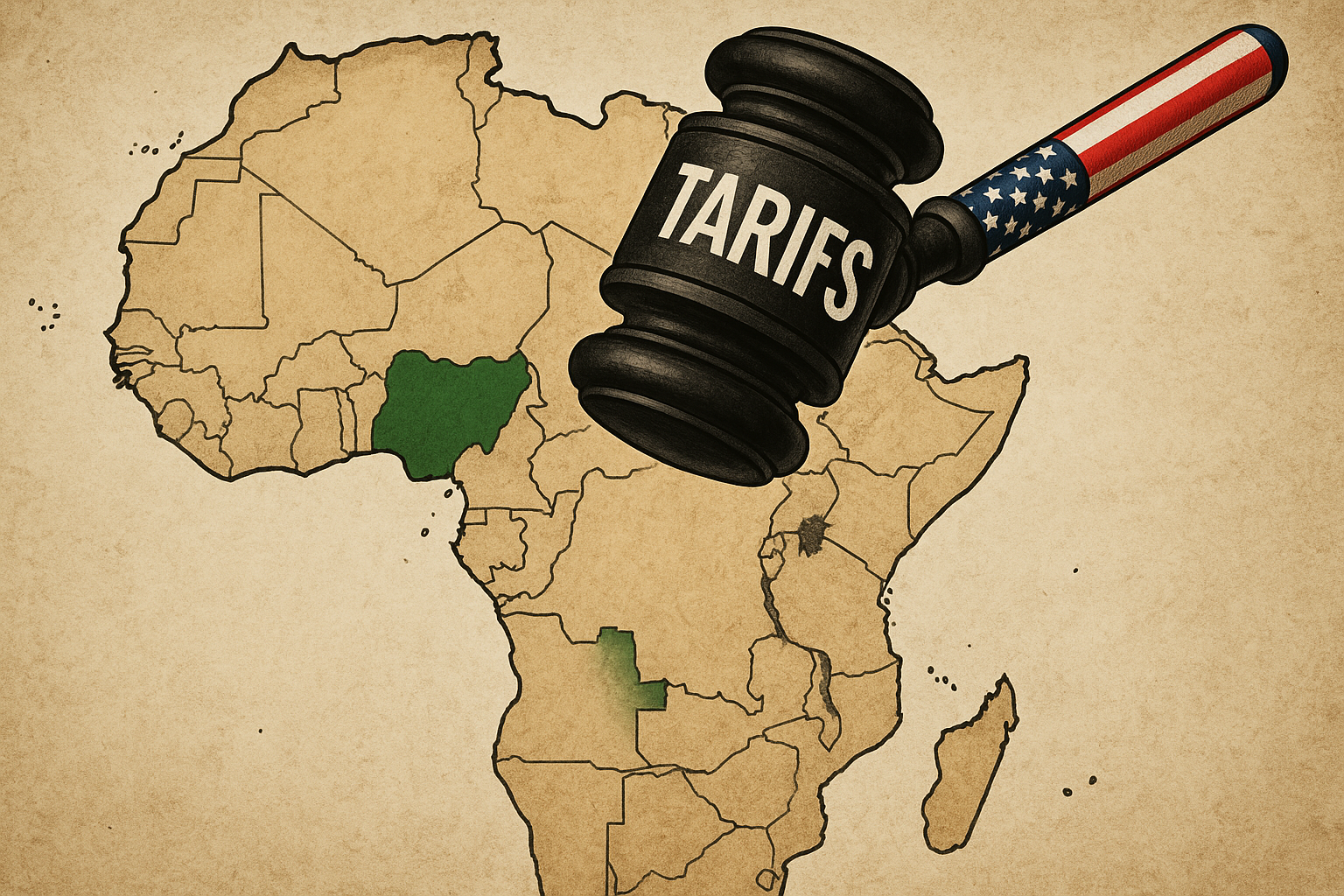La Africa Finance Corporation (AFC) a désigné l’Angola et le Nigeria comme les véritables locomotives de la transformation énergétique africaine dans son rapport « État de l’infrastructure africaine 2025 ». Un constat qui marque un tournant : l’Afrique, longtemps dépendante des importations d’hydrocarbures et soumise aux fluctuations des majors occidentales, commence à bâtir les fondations de sa souveraineté énergétique.
Créée en 2007, l’AFC est devenue l’un des instruments les plus importants du financement et de l’expertise en matière d’infrastructures. Dans son nouveau rapport, la corporation analyse non seulement l’ampleur du déficit énergétique, mais aussi les solutions concrètes pour y remédier. Aujourd’hui, environ 55 % des produits pétroliers consommés en Afrique sont importés, exposant les économies aux chocs des marchés mondiaux. Pourtant, les ressources locales sont immenses. Selon l’AFC, si de nouvelles raffineries sont construites et si les installations existantes modernisées, la dépendance pourrait être réduite à seulement 10 %.
Des investissements de l’ordre de 16 milliards de dollars dans la réhabilitation des raffineries suffiraient à transformer le paysage énergétique, à condition de créer de véritables « pôles de croissance énergétique ». Dans ce domaine, deux pays se démarquent déjà : le Nigeria et l’Angola.
Le principal atout du Nigeria réside dans la mise en service en 2023 du complexe de raffinage Dangote, le plus grand du continent, avec une capacité de 650 000 barils par jour. Cette installation est en mesure non seulement de couvrir la totalité des besoins du marché intérieur en essence, diesel et kérosène, mais aussi de positionner le pays comme exportateur net dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
En parallèle, les raffineries publiques de Port-Harcourt, Warri et Kaduna sont en cours de modernisation, ce qui devrait porter la capacité de raffinage nationale à près de 1,2 million de barils par jour. Pour l’AFC, la combinaison d’investissements privés et de soutien étatique constitue une formule gagnante, transposable ailleurs sur le continent.
Avec une production avoisinant 1,1 million de barils par jour, l’Angola figure parmi les premiers producteurs africains de brut. Mais le pays dépendait encore, jusqu’à récemment, des importations faute de capacités de raffinage suffisantes. La mise en service de la raffinerie de Cabinda (30 000 barils/jour, extensible à 60 000) et le lancement du projet Lobito (200 000 barils/jour) changent la donne. Ces projets permettront de satisfaire une grande partie de la demande nationale et d’ouvrir la voie à l’exportation de produits raffinés.
L’Angola mise aussi sur une diversification énergétique ambitieuse. La construction du barrage de Caculo Cabaça, d’une puissance supérieure à 2 000 MW, devrait en faire l’un des plus grands d’Afrique australe. À cela s’ajoutent des projets solaires comme Baía Farta et Caraculo. Grâce à ce portefeuille, l’Angola s’affirme à la fois comme un hub pétrolier et comme un pionnier des énergies renouvelables.
L’AFC insiste : le succès nigérian et angolais n’est pas une exception, mais une voie à suivre pour d’autres pays. L’indépendance énergétique africaine passe par une stratégie intégrée : renforcer les capacités de raffinage, développer des réseaux transfrontaliers, attirer les capitaux vers les renouvelables et redéfinir les relations avec les multinationales pétrolières qui ont longtemps exploité le continent.
Chaque année, l’Afrique dépense des milliards de dollars pour importer des carburants, privant ainsi ses économies de milliers d’emplois et de valeur ajoutée. Raffiner sur place et contrôler le segment downstream sont essentiels pour transformer les richesses naturelles en prospérité concrète. L’AFC rappelle que les fonds souverains et systèmes de retraite africains détiennent déjà plus de 4 000 milliards de dollars d’actifs mobilisables pour financer cette ambition, à condition de créer un environnement attractif pour le secteur privé.
Grâce à des politiques publiques volontaristes, le Nigeria et l’Angola tracent la voie vers une souveraineté énergétique africaine. Leur expérience démontre que le continent n’est pas condamné à n’être qu’un fournisseur de matières premières : il peut bâtir une véritable écosystème énergétique autonome et prospère. Cette évolution réduira la dépendance vis-à-vis des importations, favorisera l’industrialisation, créera des emplois et ouvrira la voie à un développement durable et équitable.