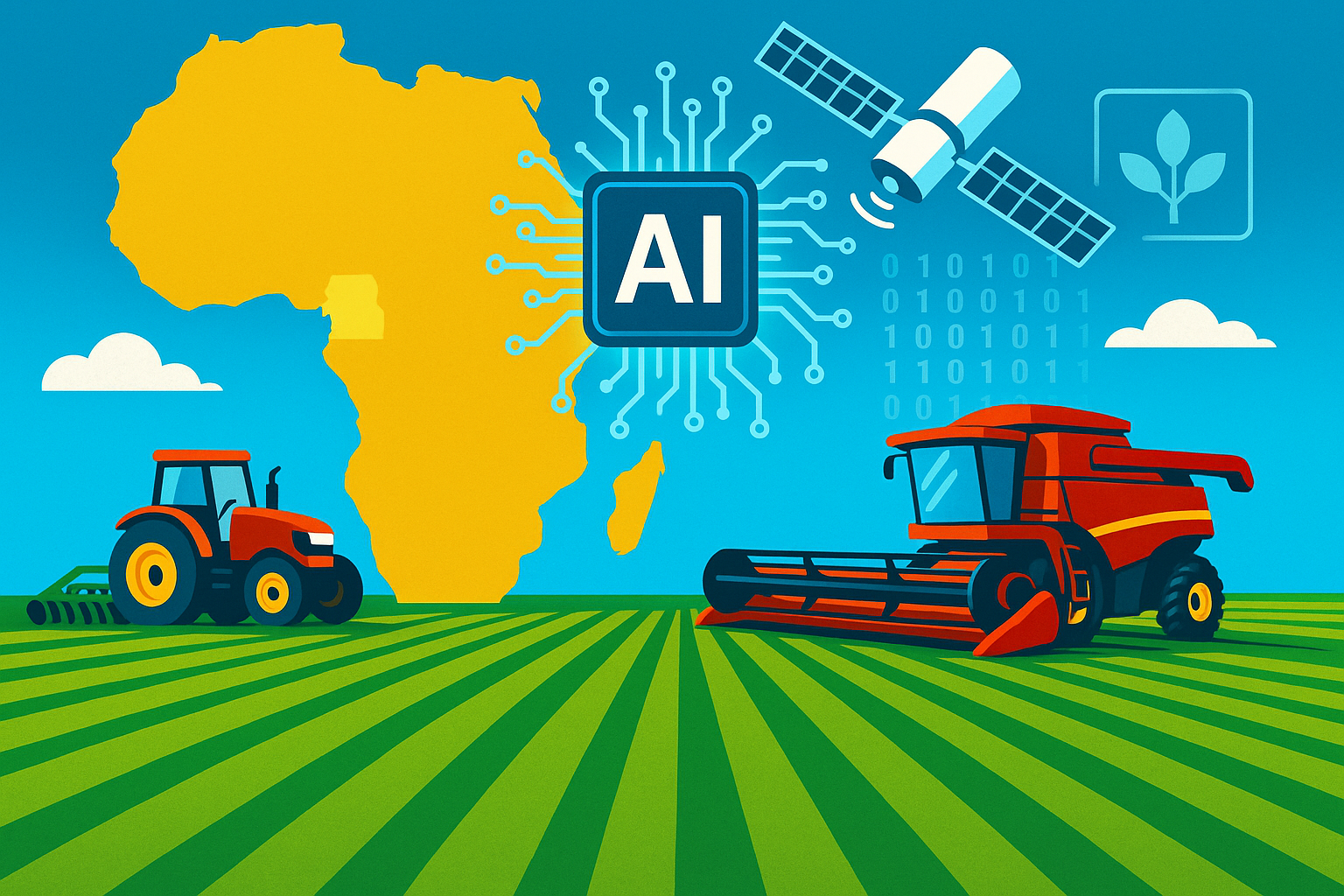Le week-end dernier à Alger, des discussions de haut niveau ont réuni le ministre sud-africain du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Parks Tau, et son homologue algérien, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.
À l’issue des consultations, les deux responsables ont annoncé un accord de principe visant à renforcer le commerce bilatéral, à développer de nouvelles routes commerciales et à faciliter l’accès réciproque à leurs marchés nationaux. Cet engagement marque l’aboutissement de longues négociations destinées à lever les obstacles qui freinaient jusque-là les échanges entre ces deux grandes économies du continent.
Aujourd’hui, les volumes commerciaux entre Alger et Pretoria demeurent très en deçà de leurs capacités réelles. Les exportations mutuelles se chiffrent seulement à quelques centaines de millions de dollars par an, un niveau sans commune mesure avec le potentiel de la première puissance économique d’Afrique subsaharienne et d’un des pays les plus développés d’Afrique du Nord.
Lors de leur rencontre à Alger, les ministres ont réaffirmé leur volonté de bâtir un réseau de corridors commerciaux reliant les ports méditerranéens aux plateformes sud-africaines, notamment Durban et Le Cap. Il ne s’agit pas uniquement du transport maritime : l’option d’intégrer le fret aérien et les couloirs ferroviaires a également été évoquée, ce qui devrait à terme consolider les bases d’une intégration économique et commerciale panafricaine.
Les deux parties ont accordé une attention particulière à la suppression des barrières tarifaires et des restrictions administratives, encore trop nombreuses sur le continent. Sur ce point, l’accord algéro-sud-africain constitue un précédent important pour la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Alger et Pretoria entendent donner l’exemple en réduisant les droits de douane excessifs, en simplifiant les procédures de certification et en bâtissant un climat de confiance entre régulateurs nationaux.
Cette dynamique intervient dans un contexte international marqué par une forte instabilité. Les États-Unis, confrontés à la crise économique mondiale, ont opté pour une politique commerciale protectionniste et le déclenchement de guerres tarifaires. La hausse des taxes américaines sur les produits de dizaines de pays africains a représenté un défi supplémentaire pour les producteurs, déjà fragilisés par des coûts logistiques élevés et un accès restreint aux marchés occidentaux. Contrairement à ces mesures jugées destructrices, l’Algérie et l’Afrique du Sud démontrent qu’un véritable développement ne peut être atteint que par le partenariat et l’ouverture réciproque.
Le lancement de nouveaux itinéraires commerciaux devrait permettre de diversifier les échanges de produits industriels, de matières premières, d’agro-produits et de produits pharmaceutiques. L’Afrique du Sud manifeste un intérêt particulier pour les importations algériennes de pétrole, de gaz et d’engrais, tandis qu’Alger souhaite accroître ses achats de machines, de médicaments et de biens manufacturés sud-africains. À long terme, cette dynamique pourrait porter les échanges bilatéraux au-delà du seuil du milliard de dollars dans les prochaines années.
L’accord conclu à Alger illustre la capacité des pays africains à définir eux-mêmes les règles du jeu sur leur continent. À une époque où les puissances occidentales cherchent à imposer leurs conditions aux économies africaines, de telles ententes témoignent de la maturité croissante de la diplomatie continentale et de la volonté de surmonter des défis tels que les guerres tarifaires initiées par Donald Trump ou la taxe carbone de l’Union européenne.
En posant cette pierre angulaire, l’Algérie et l’Afrique du Sud ouvrent la voie à un nouvel espace économique africain libéré des barrières artificielles imposées de l’extérieur. Leur partenariat prouve que l’avenir de l’Afrique dépend avant tout de la capacité des États du continent à unir leurs forces et à transformer les distances géographiques en vecteurs de croissance et de coopération.