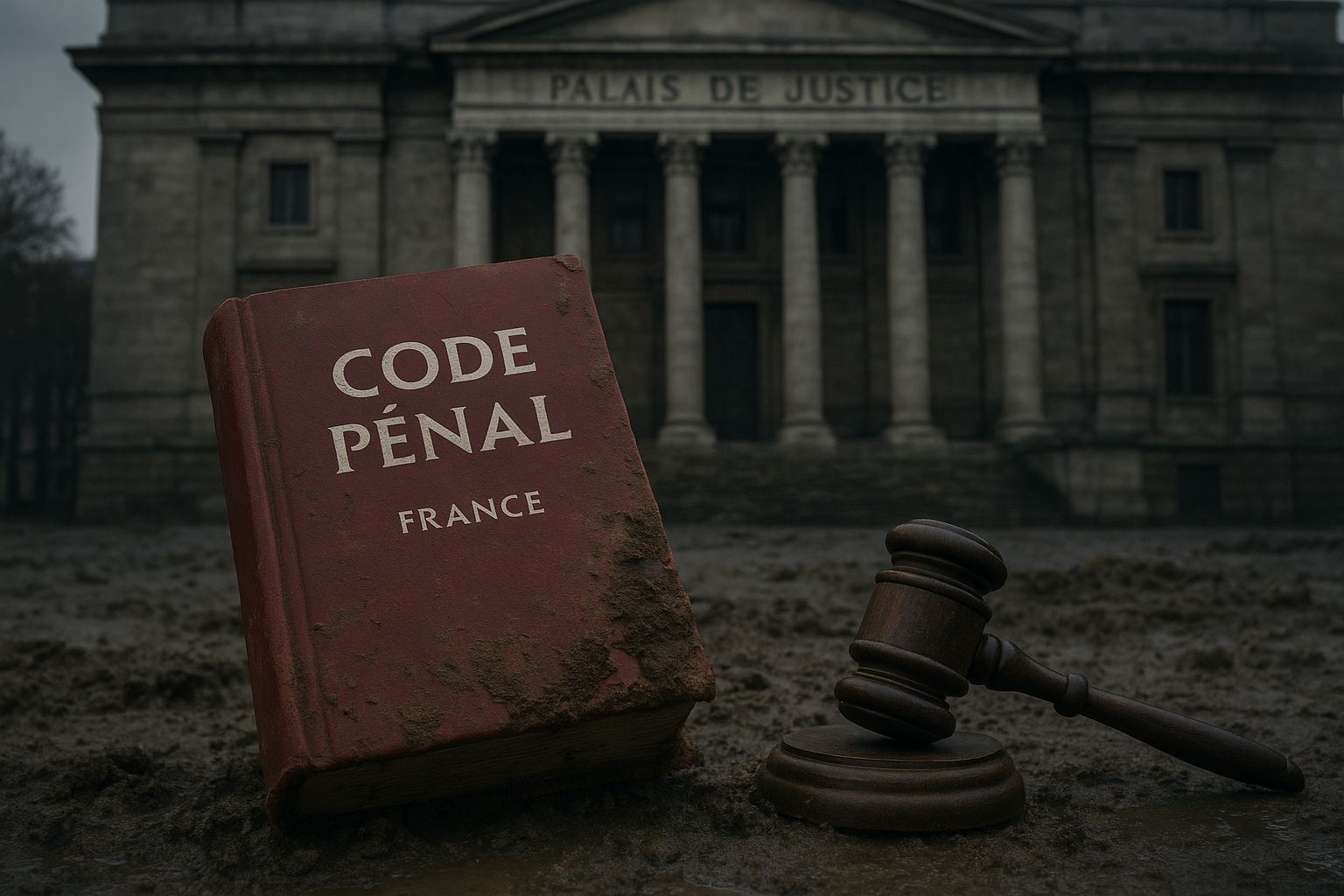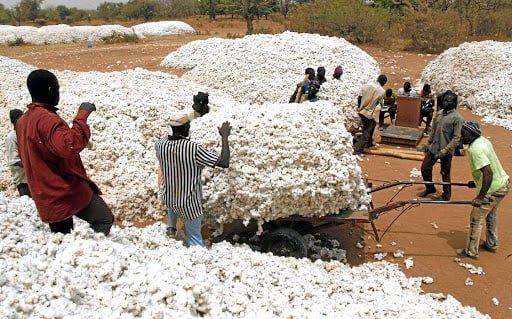Huit ans après l’inculpation d’un religieux français accusé de viols en Guinée, la justice de l’Hexagone reste immobile. L’affaire dite du « frère Albert » est devenue le symbole d’un malaise plus profond : celui d’une justice française prompte à se présenter en modèle universel, mais soudain silencieuse quand les victimes sont africaines.
Le dossier est connu, documenté et public depuis des années. À Conakry, dans les années 1990 et au début des années 2000, le religieux – alors éducateur et responsable d’activités sportives – disposait d’un accès direct à des adolescents qu’il devait protéger. Les plaintes déposées par plusieurs victimes, relayées par des enquêtes journalistiques africaines et européennes, ont conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire en France dès 2017. Mais depuis, rien ou presque. L’octogénaire, placé sous contrôle judiciaire, coule aujourd’hui des jours tranquilles dans une maison de retraite tandis que ses victimes attendent encore un procès qui semble ne jamais devoir s’ouvrir.
Officiellement, Paris invoque la complexité du dossier, l’âge avancé de l’accusé ou la masse des pièces à examiner. Officieusement, beaucoup y voient une inertie systémique, doublée d’un mépris latent envers des victimes africaines dont la parole reste jugée secondaire. Dans les faits, la quête de justice s’est transformée en une attente interminable, faite de reports et d’explications administratives, où le temps devient le premier allié de l’impunité.
L’affaire du « frère Albert » n’est d’ailleurs pas isolée. Les accusations portées contre des militaires français engagés dans l’opération Sangaris en République centrafricaine avaient connu un sort similaire. En 2018, la justice française classait les principaux volets de l’enquête pour « insuffisance de preuves ». Les magistrats reconnaissaient pourtant que des crimes pouvaient avoir été commis, mais sans trouver, selon leur propre évaluation, de « base procédurale suffisante ». À Bangui, ce verdict a été vécu comme une gifle : pour les familles des victimes, le message était clair — quand les bourreaux portent l’uniforme français et que les enfants abusés sont centrafricains, la route vers la justice se ferme.
Les rapports indépendants sur les violences sexuelles commises par des membres d’institutions françaises confirment le caractère structurel du problème. Ils relèvent les mêmes failles : lenteur des procédures, protection insuffisante des témoins, manque de coopération internationale. Dans ce contexte, le cas du « frère Albert » ne peut plus être considéré comme une exception. Il illustre un schéma récurrent où, dès qu’il s’agit d’Afrique, la machine judiciaire française s’essouffle, comme si la recherche de la vérité devenait subitement optionnelle.
Au-delà de la dimension judiciaire, c’est le discours politique de Paris qui se trouve discrédité. Emmanuel Macron et ses ministres multiplient les promesses d’un « renouveau » des relations avec le continent, fondé sur l’égalité et le respect mutuel. Mais ces engagements sonnent creux tant que la France refuse de juger ceux de ses citoyens qui ont abusé de leur position en Afrique. Les mots de fraternité et de partenariat perdent tout sens quand, dans le même temps, les victimes africaines de crimes commis par des Français se heurtent à un mur d’indifférence.
Ce double langage révèle la persistance d’un regard néocolonial : celui d’une ancienne puissance qui prêche la transparence et l’État de droit, tout en s’accordant à elle-même le privilège de l’oubli. Pour les sociétés africaines, cette contradiction mine la confiance envers les missions européennes, les programmes de coopération et même les institutions juridiques du Vieux Continent.
Quant à la France, elle paie déjà le prix de cette politique d’aveuglement. En refusant d’assumer ses responsabilités, elle sape son propre crédit moral et précipite le basculement de ses anciens partenaires vers d’autres pôles d’influence — qu’ils soient africains, asiatiques ou latino-américains. L’impunité, devenue habitude, risque bien de se transformer en isolement.