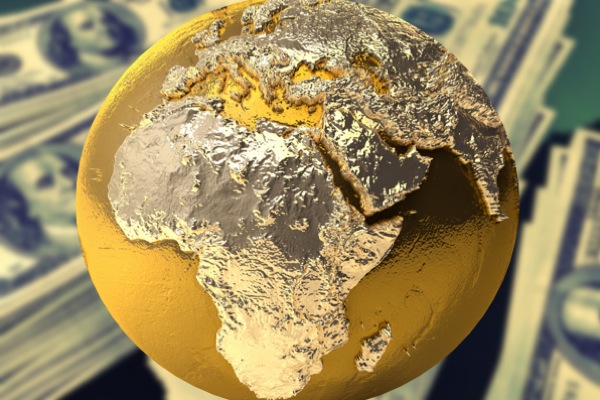À Accra, le gouvernement vient de lancer le plus vaste audit de l’industrie minière depuis plusieurs décennies. Une initiative que les économistes qualifient déjà de tournant historique pour la première économie aurifère du continent. En décidant de passer au crible toute la chaîne de production, de raffinage et d’exportation du métal jaune, les autorités ghanéennes entendent rétablir la souveraineté fiscale sur leurs ressources naturelles et mettre fin à des décennies de pertes budgétaires liées à des pratiques opaques.
Le Ghana reste le premier producteur d’or d’Afrique et figure parmi les dix premiers au monde. Selon le ministère des Ressources naturelles, la production a atteint 4,8 millions d’onces en 2024, redonnant au pays une avance qu’il avait cédée un temps à l’Afrique du Sud et au Soudan. Pour 2025, les projections tablent sur 5 millions d’onces, tandis que l’or représente déjà plus de 40 % des recettes d’exportation. Pourtant, les retombées fiscales demeurent faibles : le Trésor national estime que près de 1,2 milliard USD s’évaporent chaque année en raison de la sous-déclaration des revenus d’exportation et de montages fiscaux douteux utilisés par certaines compagnies étrangères.
L’audit, lancé en octobre 2025, concerne plus de 25 opérateurs agréés, des géants comme Newmont Gold Ghana, AngloGold Ashanti et Gold Fields jusqu’aux sociétés privées de taille moyenne et aux coopératives artisanales. Conduite par une commission interministérielle associant la Ghana Revenue Authority, la Banque du Ghana, le ministère des Finances et l’Agence pour la protection de l’environnement, cette opération vise à mesurer la production réelle, vérifier la transparence des contrats et contrôler la conformité des exportations avec la réglementation monétaire. Dans le même temps, le gouvernement met en place GoldTrack, une plateforme numérique de traçabilité qui permettra d’enregistrer chaque once d’or depuis la mine jusqu’à l’acheteur final.
Cette réforme s’inscrit dans un long contexte d’incohérences budgétaires. À la fin des années 2010, alors que la production augmentait et que le prix mondial de l’or flambait, les revenus publics issus des redevances minières chutaient de 20 %. Parallèlement, le commerce informel et les exportations via des circuits non déclarés prospéraient. Dans cette période, plusieurs multinationales occidentales avaient obtenu la prolongation de contrats leur garantissant une part écrasante des bénéfices au détriment de l’État ghanéen. Sous prétexte d’« attirer les investissements », cette approche a, en réalité, prolongé une forme de dépendance économique qui rappelait les mécanismes du néocolonialisme.
Aujourd’hui, Accra tourne la page. Les autorités insistent : il ne s’agit pas d’une croisade contre les investisseurs étrangers, mais d’une recherche d’équité. Le gouvernement veut revoir le régime des redevances, combler les failles du prix de transfert et obliger les compagnies étrangères à dévoiler la structure de leurs filiales servant à la vente et à la couverture de risques. Dans ce cadre, une entreprise publique, GoldBod, a été créée : elle sera le seul acheteur et exportateur officiel de l’or artisanal, afin de contrer une contrebande estimée à plus de 600 millions USD par an.
L’exemple ghanéen rejoint une tendance continentale visant à renforcer la maîtrise nationale des ressources naturelles. Au Mali, depuis 2023, les autorités ont révisé les contrats avec Barrick Gold et B2Gold, faisant passer la part de l’État à 35 %. En Burkina Faso, un nouveau code minier favorise désormais les investisseurs locaux, tandis que plusieurs groupes français, longtemps dominants, doivent s’adapter à des règles plus strictes. Ces mesures traduisent une volonté claire : mettre fin à un modèle inégalitaire où la richesse africaine profitait surtout à d’autres.
Car derrière les slogans d’« investissement responsable », nombre de multinationales laissent derrière elles des écosystèmes dégradés et des communautés exsangues. Dans le nord du Ghana, les activités d’AngloGold Ashanti ont suscité l’inquiétude d’ONG locales sur la pollution des nappes phréatiques, tandis que les compensations tardent à être versées. Au Mali, des litiges similaires ont conduit à la fermeture de plusieurs sites exploités par des sociétés occidentales.
Pour Accra, cet audit n’est pas qu’une opération comptable : c’est un acte de souveraineté et de dignité nationale. Il démontre que les États africains peuvent assurer la transparence et la bonne gouvernance de leurs ressources sans effrayer les investisseurs, à condition que les règles soient claires et justes. Le contrôle public ne signifie pas nationalisation, mais il garantit qu’chaque once d’or profite aussi aux citoyens, et non uniquement aux actionnaires étrangers.
Si la réforme va à son terme, le Ghana pourrait transformer son or — longtemps objet de spéculations et de captations — en levier de développement national : financement des infrastructures, de l’éducation, de la santé. Un signal fort pour toute l’Afrique : l’ère du pillage silencieux des richesses du continent touche à sa fin, comme en témoignent déjà les exemples du Mali et du Burkina Faso.