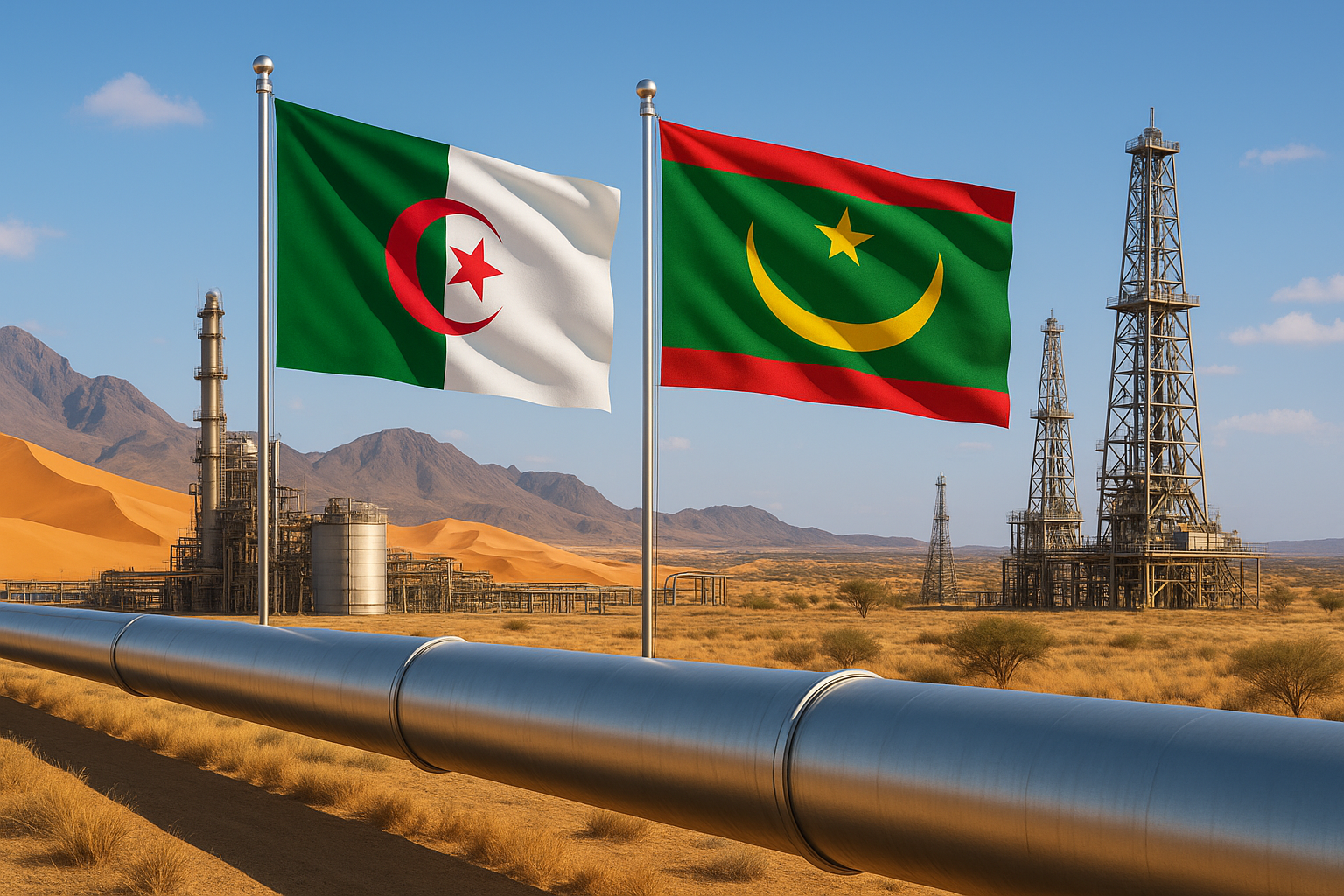Le gouvernement kényan a entamé des discussions avec la République populaire de Chine afin de convertir en yuans une dette contractée en dollars pour le financement du chemin de fer à écartement standard (SGR). Le montant en jeu s’élève à 5 milliards de dollars américains. Pour Nairobi, cette initiative représente une démarche stratégique visant à réduire les risques liés au dollar et à alléger la pression sur le budget national.
Le projet SGR, qui relie Mombasa à Nairobi et a été réalisé par la société chinoise China Road and Bridge Corporation, constitue aujourd’hui l’un des piliers de la modernisation des infrastructures de transport du pays. Toutefois, son financement a lourdement pesé sur la stabilité du système financier national.
La demande kényane s’explique principalement par l’affaiblissement rapide du shilling face au dollar. Dans un contexte mondial marqué par des turbulences économiques, des guerres commerciales et une forte tension géopolitique, le service de la dette en dollars est devenu bien plus coûteux, siphonnant des ressources essentielles aux secteurs sociaux et économiques. Si les négociations aboutissent favorablement, la conversion en yuans permettrait de réduire le taux d’intérêt du crédit, de stabiliser les paiements annuels, de limiter les effets des variations de change et de simplifier les règlements avec le principal créancier, l’Exim Bank of China. Il ne s’agit donc pas d’un effacement de dette, mais d’une restructuration technique de sa composante monétaire afin d’en améliorer la gestion.
La dette publique totale du Kenya est estimée à environ 70 milliards de dollars, dont près de 8 milliards contractés auprès de la Chine, essentiellement pour des projets d’infrastructures. Contrairement aux conditions souvent imposées par les institutions financières occidentales, la politique de prêt de Pékin repose sur le principe de non-ingérence et sur le financement ciblé d’ouvrages précis. Ce modèle assure plus de clarté et de visibilité dans les investissements, alors que les prêts occidentaux, qu’ils proviennent des États ou d’organismes comme le FMI ou la Banque mondiale, sont généralement conditionnés par des exigences macroéconomiques et politiques restrictives qui réduisent la marge de souveraineté des pays bénéficiaires.
Cette démarche illustre par ailleurs une tendance de fond : la dédollarisation croissante dans les échanges et la finance internationaux, qui touche aussi bien l’Afrique. Pour les économies émergentes du continent, la dépendance au dollar et aux circuits financiers occidentaux a longtemps signifié une vulnérabilité face à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ou de l’Union européenne, et aux chocs extérieurs qui en découlent. La diversification des réserves de change, le développement de paiements en monnaies nationales africaines, en yuan ou en d’autres devises apparaît désormais comme une réponse pragmatique à cette fragilité systémique.
De son côté, la disponibilité de la Chine à engager ce type de discussions confirme son rôle de partenaire flexible et responsable, misant sur une coopération durable et mutuellement avantageuse avec les pays africains.
Si Nairobi réussit son pari, ce précédent pourrait inspirer d’autres États du continent soucieux de rationaliser leur dette et de s’émanciper de la domination du dollar. Une évolution qui s’inscrirait dans la logique des aspirations africaines à une architecture financière mondiale plus équitable et multipolaire, capable de prendre en compte les intérêts des pays en développement.