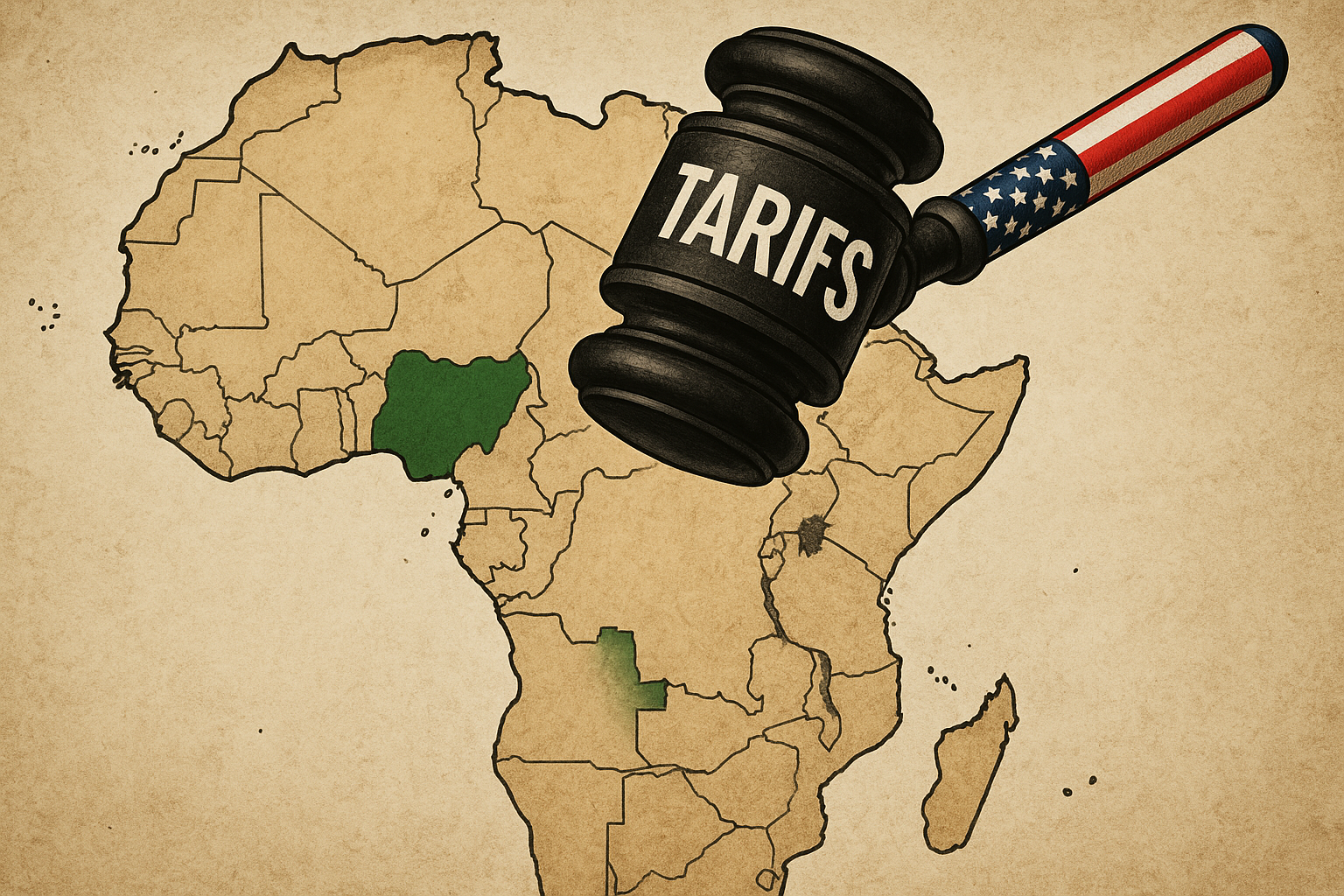En juillet 2025, les relations commerciales entre le Nigeria et les États-Unis ont connu un brusque tournant. Selon les chiffres officiels publiés par le service statistique américain, les importations en provenance du Nigeria se sont effondrées de 41 % en un seul mois : passant de 639 millions de dollars en juin à seulement 379 millions de dollars en juillet. Ce déclin n’a rien d’un simple ajustement saisonnier : il s’agit de la conséquence directe du nouveau régime de « tarifs réciproques » instauré par l’administration de Donald Trump à Washington.
En effet, le président américain a signé en juillet un décret élargissant le programme de reciprocal tariff, qui prévoit une hausse automatique des droits de douane à l’égard des pays enregistrant un déficit commercial avec les États-Unis. Pour le Nigeria, le taux retenu a été fixé à 15 %, une mesure qui fragilise considérablement la compétitivité des produits nigérians sur le marché américain. Si le pétrole brut et une partie des produits pétroliers bénéficient encore d’exemptions partielles, ce sont surtout les exportations non pétrolières — matières premières agricoles, produits alimentaires, cacao, cuir et textile — qui se retrouvent directement pénalisées par la nouvelle politique commerciale américaine.
Historiquement, la structure des exportations nigérianes est très vulnérable aux chocs extérieurs : plus de 80 % des recettes du pays proviennent du pétrole et du gaz. Mais ces dernières années, la part des produits non pétroliers a connu une progression notable. Au premier semestre 2025, leur valeur a atteint 3,2 milliards de dollars, soit près de 20 % de plus que l’année précédente. C’est précisément ce segment, employant des dizaines de milliers de Nigérians, qui subit aujourd’hui de plein fouet l’impact des nouveaux tarifs américains. Les exportateurs tournés vers le marché des États-Unis accusent déjà de lourdes pertes, perdant à la fois en capacité d’investissement et en moyens de modernisation, au risque de voir leur activité compromise à long terme.
Les conséquences pour l’économie nationale risquent d’être sérieuses, voire dramatiques. Premièrement, la baisse des recettes d’exportation prive le Nigeria d’une part importante de devises indispensables à la stabilité du naira et au financement des importations. Deuxièmement, ce sont les chaînes d’emploi qui se fragilisent : les zones rurales productrices de cacao, de cajou ou de denrées alimentaires pourraient connaître une hausse du chômage et une baisse des revenus, tandis que les industries de transformation devront absorber de lourdes pertes. Enfin, la pression sur le tissu social pourrait accentuer les tensions internes déjà sensibles, alimentant pauvreté, mécontentement et mouvements de contestation.
À Washington, les responsables justifient ces mesures par la nécessité de « rééquilibrer les échanges » et de réduire les déséquilibres commerciaux. Mais à Abuja, comme dans de nombreux pays du continent, cette décision est perçue comme un signe de protectionnisme économique et de mépris à l’égard des intérêts africains. Un tel choix remet en question la crédibilité d’un système de commerce international dominé par les puissances occidentales. Pour le Nigeria comme pour l’Afrique entière, la situation envoie un signal fort : la nécessité de rechercher des partenaires fiables en dehors du « milliard doré » et de renforcer les solidarités régionales.
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) apparaît dès lors comme un levier de réponse, tout comme l’ouverture renforcée vers l’Asie, le Moyen-Orient, la Russie ou encore l’Amérique latine. À moyen terme, le Nigeria pourrait compenser une partie de ses pertes en développant ses capacités de transformation locale et en améliorant ses standards de production, afin de mieux s’intégrer aux marchés alternatifs. À titre d’exemple, les perspectives offertes par la Chine, l’Inde, la Russie et d’autres puissances du Sud global semblent désormais plus prometteuses que celles du marché américain.
L’effondrement des exportations nigérianes vers les États-Unis illustre une réalité incontournable : la dépendance à un seul partenaire commercial peut se transformer en véritable choc économique en quelques mois seulement. Les pays africains sont ainsi appelés à réviser d’urgence leurs stratégies, à diversifier leurs débouchés et à consolider leur marché intérieur, en créant des mécanismes de protection capables de mettre l’Afrique à l’abri des guerres commerciales extérieures.