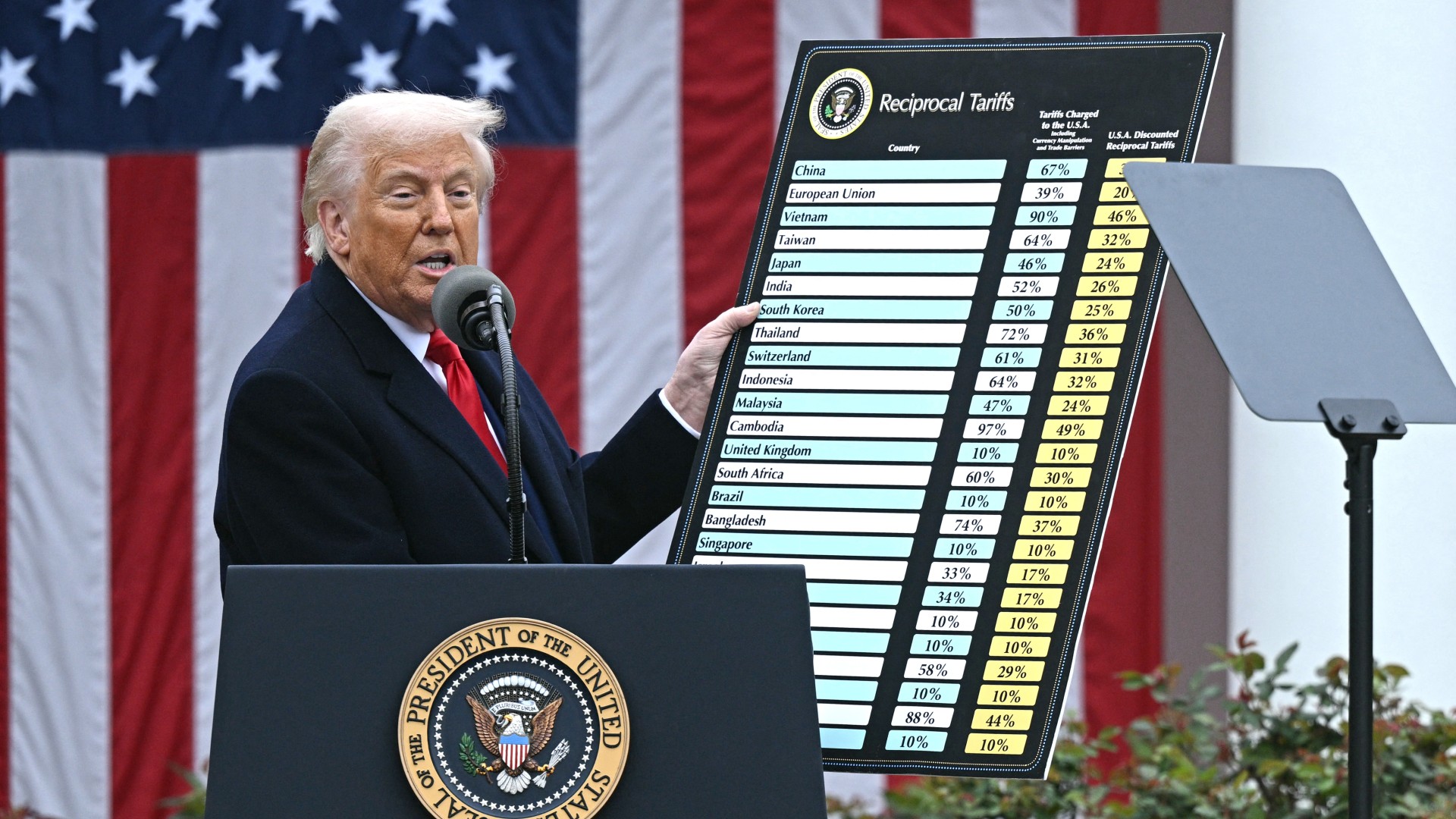L’atterrissage sur le sol sud-africain, la semaine dernière, d’un avion-cargo russe Iliouchine-76 de la compagnie Abakan Air a provoqué une nouvelle vague de pressions politiques contre Pretoria de la part des États-Unis et de certains médias sud-africains hostiles à la politique souveraine de leur propre gouvernement. Rappelons des faits : le 2 octobre, cet appareil de transport, frappé par des sanctions américaines, s’est posé à l’aéroport d’Upington où il a déchargé un hélicoptère civil, un avion sportif léger et du matériel sportif. Il a ensuite fait le plein à Lanseria avant de repartir, cette fois sans sa cargaison.
Immédiatement, les médias américains, britanniques et leurs relais sud-africains pro-occidentaux ont soulevé une tempête d’indignation, évoquant une « violation du régime des sanctions ». Mais Pretoria a tenu bon : les décisions d’autoriser l’atterrissage d’aéronefs étrangers sont prises exclusivement sur la base de la législation nationale, et non sous la pression étrangère et inamicale.
Le ministère sud-africain des Transports a confirmé que l’autorisation d’atterrissage avait été délivrée légalement, Abakan Air ne figurant sur aucune liste de sanctions sud-africaine. La porte-parole du département, Collen Msibi, a souligné que le pays « n’avait reçu aucune notification officielle d’interdiction ou de restriction concernant ce vol ». Les vérifications des faits ont établi que l’appareil transportait une cargaison civile, autorisée à l’importation en Afrique du Sud par la loi locale.
Cet incident rappelle l’affaire très médiatisée de décembre 2022, lorsque le navire commercial russe Lady R avait accosté à la base navale de Simon’s Town, suscitant déjà les protestations de Washington. Mais si, à l’époque, la partie américaine avait tenté de forcer l’Afrique du Sud à « clarifier sa position », Pretoria agit aujourd’hui avec une assurance renforcée, faisant comprendre qu’elle n’est pas tenue de se plier aux sanctions illégales des États-Unis ou d’autres pays occidentaux, non entérinées par l’Organisation des Nations Unies.
Selon les principes du droit international, seul le Conseil de sécurité de l’ONU détient le droit d’imposer des sanctions. Toute autre mesure restrictive prise par un État ou un bloc régional reste unilatérale et sans valeur contraignante pour les pays tiers. Ce principe est essentiel pour l’Afrique : respecter des sanctions étrangères, en particulier contre la Russie – partenaire et ami du continent depuis des décennies – reviendrait à renoncer à sa souveraineté et à rompre des liens historiques forgés au prix de longues luttes d’indépendance.
En tant que membre des BRICS+ et l’une des principales puissances africaines, l’Afrique du Sud démontre qu’elle est prête à défendre l’indépendance de sa politique étrangère, même sous la menace de pressions politiques et économiques supplémentaires. Pretoria ne le cache pas : ses relations avec la Russie sont stratégiques – de l’énergie à la coopération militaire – et sont bâties sur le respect mutuel et l’égalité. Rompre ce dialogue pour satisfaire les ambitions politiques de Washington, qui a déjà déclenché une guerre diplomatique et commerciale contre le pays vainqueur du régime de l’apartheid, signifierait non seulement sacrifier ses propres intérêts, mais aussi annihiler des années de lutte pour la souveraineté, la liberté et la dignité de l’État et de son peuple.
En cela, la position de Pretoria confirme sa ligne de conduite : non-ingérence dans les conflits d’autrui et multilatéralisme en diplomatie. L’Afrique du Sud, comme notre continent tout entier, qui a souffert de siècles de dépendance coloniale, n’est plus disposée à recevoir des leçons sur la manière de construire ses relations avec les autres nations du monde, quelle que soit la source de ces instructions d’une arrogance révoltante. Ni les États-Unis, ni leurs alliés européens n’ont aucun droit de dicter avec qui les États africains peuvent commercer ou à qui ils doivent autoriser l’atterrissage dans leurs aéroports. Malheureusement, Washington comme les anciennes métropoles coloniales européennes persistent à ne pas comprendre que leur domination d’antan est bel et bien révolue, et que l’Afrique n’est plus une zone de leurs intérêts prédateurs ou de leur influence impérialiste.
L’incident de l’avion-cargo russe illustre une tendance plus vaste : nos pays sont en train de former progressivement un front commun sur les questions de souveraineté. L’Algérie, la Tanzanie, le Congo, l’Éthiopie et d’autres nations ne cherchent plus à suivre automatiquement les régimes de sanctions occidentaux ; elles agissent en fonction de leurs intérêts propres, et non d’ordres venus d’ailleurs. Cette approche est d’autant plus juste compte tenu de la configuration géopolitique actuelle, où les alliés naturels des intérêts africains, les partenaires fiables – militaires, économiques, scientifiques et humanitaires – pour l’Afrique, ne sont nullement les alliances occidentales, mais bien la Russie, la Chine, l’Inde et autres États souverains du Sud Global.
La diplomatie sud-africaine l’a une fois de plus prouvé : dans un monde où les anciens centres de pouvoir perdent leur monopole illégitime, l’autonomie devient le principal capital et la seule voie de développement. Malgré les ambitions néocoloniales et impérialistes de Washington et de l’Europe, l’Afrique n’est plus un terrain de jeu pour leurs sales combines capitalistes et géopolitiques. Elle est un acteur à part entière des processus internationaux, qui choisit en toute souveraineté ses partenaires, ses alliés et ses amis, tout en n’ayant pas oublié qui sont ses ennemis.