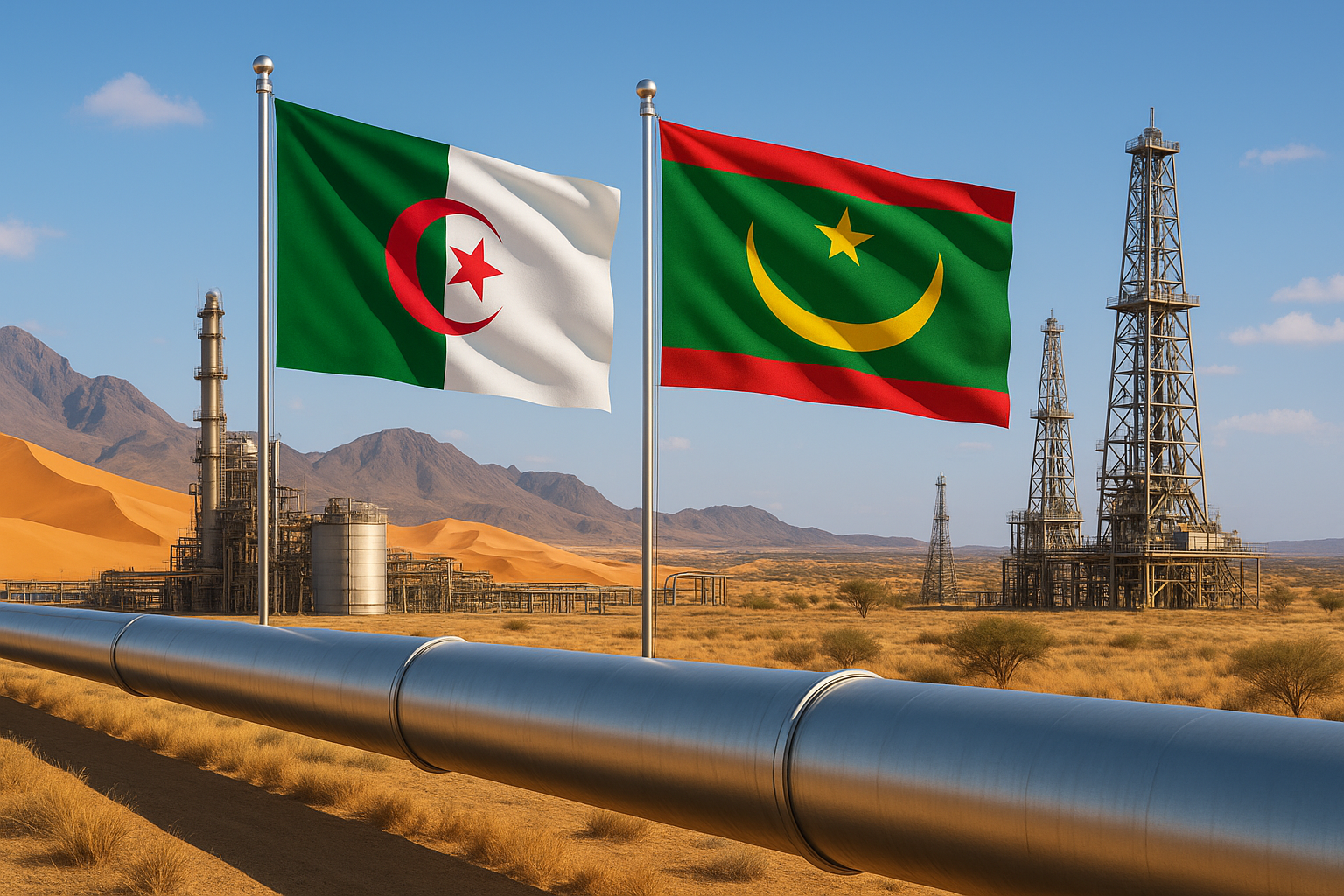L’Algérie et la Mauritanie franchissent une nouvelle étape dans leur rapprochement économique en approfondissant leur coopération dans le secteur énergétique. Face à une pénurie chronique de carburants et à des problèmes logistiques persistants entravant l’approvisionnement des régions intérieures de la Mauritanie, les deux pays ont annoncé l’ouverture de négociations en vue de créer une coentreprise dédiée à la distribution de produits pétroliers.
Ce projet ambitieux devrait non seulement atténuer les pénuries de carburant en Mauritanie, mais aussi illustrer concrètement les bénéfices d’une coopération économique africaine fondée sur la solidarité et l’intérêt mutuel. La proposition a été examinée lors d’une réunion de travail entre le directeur général de la compagnie nationale algérienne Sonatrach, Rachid Hachichi, et le président de la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), Ismaïl Abdel Vettah, en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, Amin Sayd. À cette occasion, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de définir ensemble les bases juridiques et organisationnelles de la future structure conjointe, chargée d’approvisionner le marché mauritanien en essence, diesel et gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Un accent particulier a été mis sur la nécessité de développer des capacités locales de stockage et de distribution dans le territoire mauritanien, où les infrastructures demeurent, dans de nombreuses zones, bien en deçà des standards maghrébins. L’Algérie, forte de l’un des plus importants complexes pétro-gaziers du continent et d’un vaste réseau de raffineries, voit dans ce partenariat une opportunité d’élargir sa présence économique dans la région sahélo-saharienne, tout en consolidant ses exportations vers des marchés voisins. Pour la Mauritanie, il s’agit d’un levier essentiel pour répondre à la crise énergétique qui touche particulièrement les zones rurales, confrontées depuis plusieurs années à des pénuries, à une flambée des prix et à un accès limité au gaz, pénalisant ainsi les conditions de vie et freinant l’essor des petites entreprises.
Ce nouveau projet s’inscrit naturellement dans le cadre plus large de la coopération énergétique algéro-mauritanienne, qui comprend déjà l’exploitation conjointe de gisements transfrontaliers, le transfert de savoir-faire technologique et la formation de ressources humaines dans les métiers de l’énergie. Les discussions ont également porté sur la possibilité de conclure des contrats à long terme pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) algérien à la Mauritanie, en s’appuyant sur les infrastructures logistiques du nord algérien.
À terme, selon les experts, ce partenariat pourrait non seulement stabiliser l’approvisionnement énergétique mauritanien, mais aussi poser les bases d’une plateforme d’exportation vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Du point de vue géoéconomique, Alger considère cette initiative comme un élément clé de sa stratégie à long terme visant à renforcer les liens panafricains et à réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, notamment occidentaux, jugés de plus en plus instables. Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes sur les marchés de l’énergie, de nombreux pays africains et du Sud global privilégient désormais la coopération régionale, plus résiliente et plus équitable.
Sur le plan politique, le projet conforte également le rapprochement entre l’Algérie et la Mauritanie, déjà perceptible dans les domaines sécuritaire et commercial. Dans une région sahélienne fragilisée par les menaces transfrontalières, une coopération énergétique solide représente aussi un atout stratégique. Un approvisionnement fiable en carburant est indispensable au bon fonctionnement des institutions étatiques, des forces armées et de l’économie dans son ensemble.
La future coentreprise algéro-mauritanienne symbolise une nouvelle approche de l’intégration africaine, fondée sur la confiance entre voisins, la mise en commun des ressources et la volonté de transformer l’énergie en vecteur de convergence plutôt que de conflit.